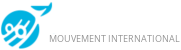Je suis étudiant·e. Qu’est-ce que je peux faire pour éliminer la pauvreté ?

 Temps de lecture: 7 minutes
Temps de lecture: 7 minutes
La pauvreté est une expérience profondément multidimensionnelle. Selon ATD Quart Monde, elle enlève aux individus le contrôle sur leur vie et implique une lutte constante pour faire reconnaître sa dignité. Bien sûr, on y trouve aussi le manque de travail décent, des revenus insuffisants ou instables, ainsi qu’une privation matérielle et sociale. Mais elle se manifeste aussi dans la manière dont les personnes en situation de pauvreté sont perçues et traitées : à travers les maltraitances sociales et institutionnelles, et l’absence de reconnaissance de leurs contributions. Toutes ces dimensions sont étroitement liées et influencées par des facteurs plus larges comme l’identité, la culture ou l’environnement. C’est une réalité structurelle et complexe, nous devons l’aborder comme telle. Car ce n’est qu’en reconnaissant cette complexité que nous pourrons la transformer.
En tant qu’étudiant·e·s, il nous arrive de nous demander : quel pouvoir avons-nous devant un problème aussi grand ? Comment peut-on contribuer de manière significative face un défi mondial qui nous dépasse ?
On peut commencer par reconnaître le privilège qu’on a de pouvoir étudier. Tout le monde n’a pas accès à une salle de classe. Pour beaucoup, étudier n’est pas un droit, mais un rêve. Parfois, nous l’oublions, pris dans la pression de réussir, d’avancer, de produire. Mais apprendre peut aussi être un acte de solidarité, une façon de se relier au monde. Réduire l’éducation à une simple voie vers le succès personnel, c’est passer à côté de sa puissance. Et si on la concevait comme une manière d’être avec les autres, d’agir ensemble ?
Mais alors, comment mettre cela en pratique ?
Ce sont les questions qui m’ont accompagnée tout au long de mon stage chez ATD Quart Monde, une organisation internationale de lutte contre la pauvreté qui travaille en partenariat avec celles et ceux qui vivent cette réalité de l’intérieur. Grâce à cette expérience, j’ai compris que même si, en tant qu’étudiant·e·s, nous n’avons pas accès au pouvoir économique ou institutionnel, nous disposons d’autres formes d’influence : notre attention, notre empathie, notre engagement sur la durée. Nous avons la capacité de créer des liens, de faire circuler des idées, de s’engager dans des luttes avec conviction et respect. Nos gestes peuvent sembler modestes, mais ils ne sont pas insignifiants.
ATD Quart Monde part du principe que les personnes en situation de pauvreté doivent être au cœur des efforts pour mettre fin à la pauvreté. Ce positionnement change radicalement notre manière d’envisager la justice sociale : il ne s’agit pas « d’aider » les personnes concernées, mais de travailler avec elles, d’apprendre d’elles. J’ai compris que la pauvreté n’est pas seulement matérielle. Elle est aussi émotionnelle, sociale et spirituelle. Elle parle d’exclusion, de silence, de honte. Mais aussi de résistance, de dignité et de résilience.
L’une des méthodes centrales d’ATD, le Croisement des savoirs, a été créée en 1993 pour permettre à des personnes ayant vécu la pauvreté de réfléchir et de contribuer sur un pied d’égalité avec des chercheurs et des professionnels. Cette approche participative remet en question les hiérarchies traditionnelles du savoir, en reconnaissant que ceux qui vivent la pauvreté détiennent des connaissances précieuses, issues de leur vécu et transmises de génération en génération. Surmonter la pauvreté et l’exclusion sociale commence par reconnaître ces personnes comme des actrices à part entière, et non comme de simples bénéficiaires ou objets d’étude.
Contester l’idée qu’on n’a pas le pouvoir de changer les choses
En partageant mon expérience avec des ami·e·s — notamment avec María, une étudiante mexicaine de 21 ans qui étudie la philosophie, la danse et les sciences politiques aux États-Unis —, j’ai réalisé que beaucoup d’étudiant·e·s aujourd’hui portent un sentiment profond de désespoir. Nous avons parlé de la dette étudiante, des nombreux emplois à cumuler, de la peur de décevoir nos familles, du coût toujours plus élevé de la vie. Tout cela dans un contexte de haine croissante, de polarisation et d’abandon institutionnel.
María et moi avons évoqué combien il peut être solitaire de continuer à ressentir dans un monde qui semble parfois anesthésié. Mais en nous écoutant, nous avons aussi trouvé de la force. Nous nous sommes rappelé que l’amour est politique, que prendre soin est un acte radical, et que l’amitié — une amitié empathique, attentive, engagée — peut être une forme de résistance. Quand nous nous soutenons, quand nous faisons du bénévolat, quand nous prenons conscience que nous avons déjà une place à la table, et que d’autres en sont encore exclus, nous remettons en question, dans le quotidien, les systèmes qui isolent et déshumanisent. Être attentif, partager notre espace, agir en conscience de nos privilèges — c’est déjà une manière de transformer.
Faire du bénévolat dans une organisation comme ATD Quart Monde peut sembler une goutte d’eau dans l’océan — mais c’est une goutte puissante. Cela conteste l’idée que nous n’avons pas de pouvoir. Cela réaffirme que l’action collective commence par des choix simples, répétés chaque jour. Cela nous permet de relier nos savoirs académiques aux luttes concrètes, et de ne pas oublier que la théorie sans action est vide de sens.
En tant qu’étudiant·e·s en relations internationales, en sciences politiques ou en philosophie, on nous dit souvent que les vraies opportunités — et l’argent — se trouvent dans la sécurité, la politique étrangère ou le conseil. Le travail dans le développement ou la lutte contre la pauvreté est trop souvent jugé idéaliste, « mou », ou peu viable. Mais cette mentalité fait partie du problème. Si nous voulons un monde où la dignité humaine passe avant le profit, alors nos choix — de stages, de causes, de carrières — doivent le refléter.
La pauvreté n’est pas une fatalité
Être dans la vingtaine aujourd’hui, c’est parfois comme se tenir au bord d’un précipice. Nous avons accès à plus d’informations que jamais, mais cette exposition constante à la souffrance, à l’injustice, à l’urgence peut nous engourdir. Nous voyons l’ampleur des problèmes, et pourtant nous nous sentons impuissants. Cette impression d’avoir déjà tout essayé, d’être là et que cela ne suffise pas, se transforme peu à peu en une fatigue profonde — une sorte d’habitude à ne plus attendre de changement. Il est facile de glisser dans une forme d’impuissance apprise, où la conscience ne pousse plus à l’action, mais paralyse. On nous dit que nous sommes « l’avenir », mais nous vivons dans un présent qui est en feu.
Et pourtant, je crois que notre génération peut transformer les choses. Si quelque chose nous unit, c’est peut-être ce sentiment partagé d’impuissance. Mais paradoxalement, ce sentiment peut devenir une source de force. Il nous relie au-delà des frontières, des disciplines, des identités. Il nous pousse à sortir de l’individualisme pour rejoindre le collectif. Car seul, le changement est impossible — mais ensemble, il devient inévitable. Que ce soit en participant à une réunion de quartier, en lisant un livre écrit par quelqu’un qui a vécu la pauvreté, ou simplement en initiant une conversation, chaque pas compte.
Pour María et moi, ces petits gestes sont déjà en train de transformer notre manière de nous percevoir : non plus comme des témoins impuissants, mais comme des actrices du changement. Et c’est une possibilité ouverte à chacun·e, même dans la fatigue, la confusion ou la surcharge de travail.
La pauvreté ne disparaîtra pas du jour au lendemain. C’est un problème historique, systémique, profondément enraciné. Mais ce n’est pas une fatalité. En tant qu’étudiant·e·s, nous avons la possibilité de redéfinir ce que signifie avoir du pouvoir. Nous pouvons choisir l’empathie plutôt que l’indifférence, la justice plutôt que le cynisme. Nos études ne sont pas séparées du monde réel — elles en font partie. Et plus nous relions ce que nous apprenons à la manière dont nous vivons, plus notre éducation prend sens.
La lutte contre la pauvreté commence avec nous — non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous sommes prêts à poser les bonnes questions et à marcher aux côtés de celles et ceux qu’on a trop longtemps ignorés. Et sur ce chemin, peut-être trouverons-nous non seulement un sens, mais aussi une communauté.

rdd
Texte écrit par Ana Patricia Romay Febres